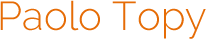LANDSCAPE 2015
Cette photographie a été prise le long d’une voie rapide, d’une pénétrante, aux abords d’une grande ville. Au premier plan : des arbustes, prémices d’un paysage contrarié à la perspective brutalement close par un mur de béton. La surface de ce dernier est maculée de traces de toutes sortes laissées par des vrilles de vignes vierges sans doute arrachées dont certains tronçons sont encore visibles, par des écoulements ou par le développement de mousses, par la pollution. Autant d’éléments qui composent et structurent cette prise de vue en apparence banale. Cette banalité triste et muette, dénuée de toute poésie, est celle du paysage urbain qui défile ordinairement devant nous sans que nous nous y arrêtions, sans que nous y prêtions la moindre attention, que l’on soit conducteur d’un véhicule ou simple passant. Paolo Topy nous rend compte, ici, de ce qui « est », dans le cas présent, une part du monde extérieur. Il n’y a pas, venant de lui, de construction d’un récit fictionnel, imaginaire. Le propos est descriptif. Nous faisons nous aussi, en regardant cette photographie un exercice de description instantanée. Nous appréhendons, par son entremise, le réel tel qu’il est. En choisissant cette réalité comme sujet, il lui confère une valeur nouvelle. Elle serait digne d’intérêt, prendrait « sens ». Mais quel est-il ? Il semble nous dire : arrêtons-nous un instant, regardons plus attentivement. Cette invite modifie notre rapport à cette réalité par l’entremise d’une relation au temps et à l’espace volontairement perturbée. Il a pris ce cliché de manière très frontale. Cette frontalité impose une manière de regarder, très directe sans possibilité d’y échapper. Nous nous devons de nous inscrire dans une relation à l’œuvre qui est celle voulu par l’artiste. En regardant cette image, nous acceptons de jouer le jeu, aussi, d’une rencontre avec Paolo Topy, avec sa pensée. Nous acceptons de le suivre, de vivre l’expérience qu’il nous propose. Quelle est-elle ? Après quelques instants où nous nous trouvons déroutés par cette banalité statique et, en apparence non signifiante, nous nous retrouvons affectés par elle. Nous sommes dans l’incapacité de « dire ». Nous sommes pris au piège d’un mutisme qui nous atteint à notre tour face à ce désenchantement du réel. Il nous faut, alors, nous « situer dans sa pensée » pour reprendre des termes chers à l’écrivain, poète et critique d’art Alain Jouffroy (1928-2015), nous situer dans la pensée de l’artiste qui a voulu, par stratégie, nous désorienter. Cette stratégie va nous conduire à vivre cette expérience qui nous fera voir et vivre le réel autrement. Étonnamment, le regard, loin de s’arrêter, d’être stoppé par ce mur, se perd sur cette surface de béton qui semble rapidement se dérober à notre regard, se dématérialiser. La matière disparaît. Un nouvel espace éventre littéralement l’omniprésence de cette dernière qui semblait faire totalement obstruction à toute possibilité de discours. De manière surprenante, chacune de ces traces visibles sur la surface en béton, bien qu’ancrée dans la réalité, participant de cette dernière, devient signe et donne l’impression de participer d’un vocabulaire très personnel qui semble être celui du concepteur de ce cliché. Mais il n’en est rien. Ces signes préexistants, organisés mentalement par lui, permettent l’émergence d’une image autre maintenant que nous véhiculons au travers de sa pensée. Ce vocabulaire compose, en fait, une nouvelle éventualité construite et donnée à voir, à percevoir par l’artiste et qui vient se superposer à la réalité par son intermédiation entre cette dernière et le regardant. La réalité, encodée par l’entremise très technique de l’appareil et de l’acte photographique, est simultanément décodée par ce filtre singulier que sont le regard et la pensée de l’artiste. Paolo Topy a perçu l’intérêt de cette réalité grise marquée par la tentative génétiquement programmée mais vaine de ces plantes à envahir ce qui doit l’être, par ces stigmates de l’altération lente et inéluctable de la matière. Il augmente cette réalité et révèle sa complexité et son potentiel d’évocation. Nos sens sont sollicités. Le souvenir de paysages aperçus et, peut-être même, de paysages peints ou dessinés, nous envahit. Nous transposons ces images enfouies dans notre mémoire sur cette surface qu’il nous faut alors peindre de nos souvenirs. Chaque élément, aussi modeste qu’il soit de la réalité, compose un nouveau paysage qui apparait soudainement, inventé par l’imaginaire du regardant que nous sommes, construit par ce dernier à partir de ce vocabulaire visuel proposé par l’artiste. Un système de « briques » en somme, mis à notre disposition et que nous nous approprions et reformulons pour construire. C’est nous, regardant, qui finalement réussirons à « envahir » et à compléter non pas la réalité brute et première mais celle, nouvelle, offerte par l’intermédiaire de nos yeux à notre imaginaire par Paolo Topy. C’est le manque de perspective pour le regardant, cette « souffrance » quotidienne pour l’habitant des zones hyper-urbanisées, qui stratégiquement révélée et organisée par l’artiste, va provoquer cette volonté inconsciente de combler ce désir de fuite, cette volonté d’échapper à cette réalité mortifère et provoquer l’envie d’un ailleurs, d’une autre perspective, d’un lointain trop éloigné ou, peut-être, simplement rêvé. Cette expérience, partagée avec l’artiste, nous fait prendre soudain conscience de la dureté de ce que nous vivons au quotidien dans un environnement urbain et que nous n’avons, par faiblesse, lassitude et découragement, pas toujours le courage de remettre en question. Notre mode de vie accéléré, où nous ne prenons pas toujours le temps de nous arrêter vraiment et de regarder, nous donne rarement la possibilité de le faire, de toute façon ! Avec cette photographie, ironiquement intitulée « Landscape », nous avons vu que nous étions invités à dépasser notre perception du réel, à voir et à percevoir autrement, à vivre ce réel différemment. Cette expérience inattendue et enrichissante consacre cette rencontre entre l’artiste, son œuvre et l’imaginaire nourri du ressenti et de l’affect de celui qui, un instant, joue le jeu de ce champ des possibles aux perspectives illimitées et toujours changeantes qu’est l’expérience de l’art. On se souvient, alors, des propos du philosophe Henri Bergson (1859-1941) dans son ouvrage La pensée et le mouvant paru en 1938 : « A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience? ».
Yves Peltier